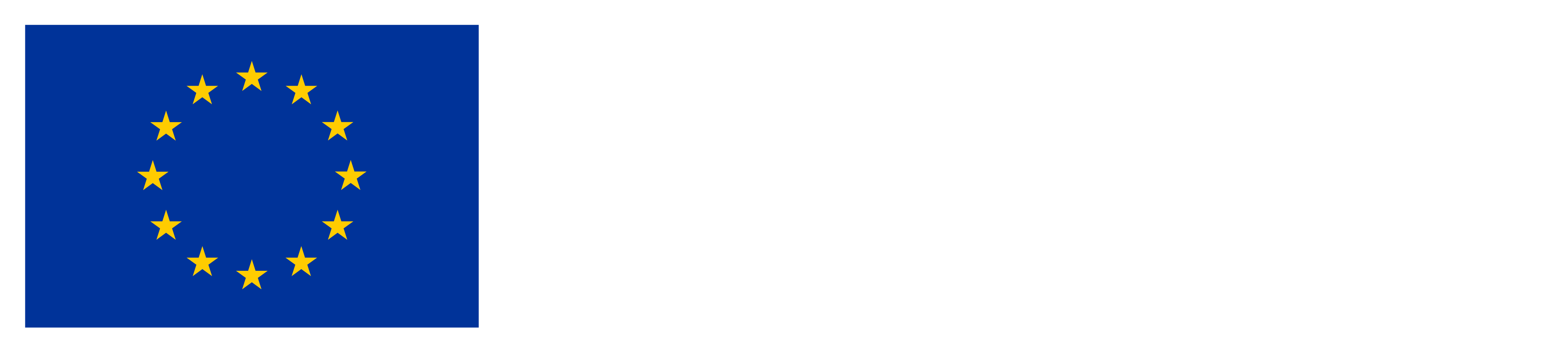À la Une
Monde
13 mai 2025
Journée du 10 mai : se souvenir de l’esclavage et de son histoire
Le 10 mai est la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. Instaurée en 2006, elle rend hommage aux millions de femmes, d’hommes et d’enfants victimes de l’esclavage colonial. Elle fait écho à la loi adoptée le 10 mai 2001, portée par Christiane Taubira, députée de la Guyane, qui reconnaît l’esclavage et la traite comme crimes contre l’humanité.L’esclavage existe depuis l’Antiquité et a été pratiqué dans de nombreuses sociétés à travers l’histoire. À partir du XVe siècle, les puissances européennes (comme la France, le Portugal, les Pays-Bas, le Royaume-Uni), mettent en place un système d’une ampleur inédite : la traite transatlantique. Elle repose sur le commerce d’Africains capturés, vendus, transportés de force et réduits en esclavage. Plus de 12,5 millions de personnes ont ainsi été déportées, dont environ 1,5 million sont mortes pendant la traversée. Dans ce cadre, environ 1,3 million d’Africains ont été déportés par la France vers ses colonies d’Amérique, notamment en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti) et en Guyane. Une autre traite a eu lieu dans l’océan Indien, vers des colonies comme La Réunion et l’île Maurice, avec des captifs venus principalement de Madagascar ou de l’Afrique de l’Est.Forcés à travailler dans les plantations de canne à sucre, de café ou de coton, ils étaient privés de droits, soumis à des violences quotidiennes. Le Code noir, signé en 1685, donnait au maître un pouvoir quasi absolu, et précisait que les enfants nés d’une mère esclave le devenaient aussi, perpétuant le système. Ce système, basé sur une main-d’œuvre gratuite, a largement contribué à la richesse des puissances européennes, en développant le commerce maritime et des ports comme Bordeaux ou Nantes.L’esclavage était alors justifié par des arguments économiques, religieux et racistes. On le disait indispensable à la richesse des colonies. Certains affirmaient que les Noirs étaient inférieurs, et que l’esclavage les rendait « civilisés », en les convertissant au christianisme.En France, l’abolition a été proclamée une première fois en 1794, sous la pression des révoltes, notamment à Saint-Domingue. Napoléon rétablit l’esclavage en 1802. L’abolition définitive n’interviendra qu’en 1848, sous la Deuxième République.Adoptée en 2001, la loi Taubira a marqué un tournant en reconnaissant l’esclavage comme crime contre l’humanité et en imposant son enseignement à l’école. Depuis, des lieux comme le Mémorial ACTe en Guadeloupe rappellent cette histoire. Le 10 mai invite à transmettre cette mémoire et à réfléchir à ses héritages encore présents aujourd’hui.